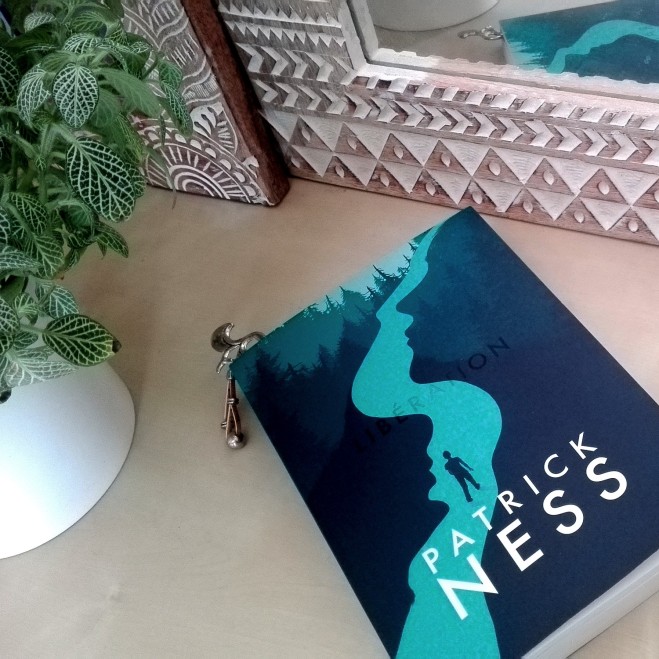
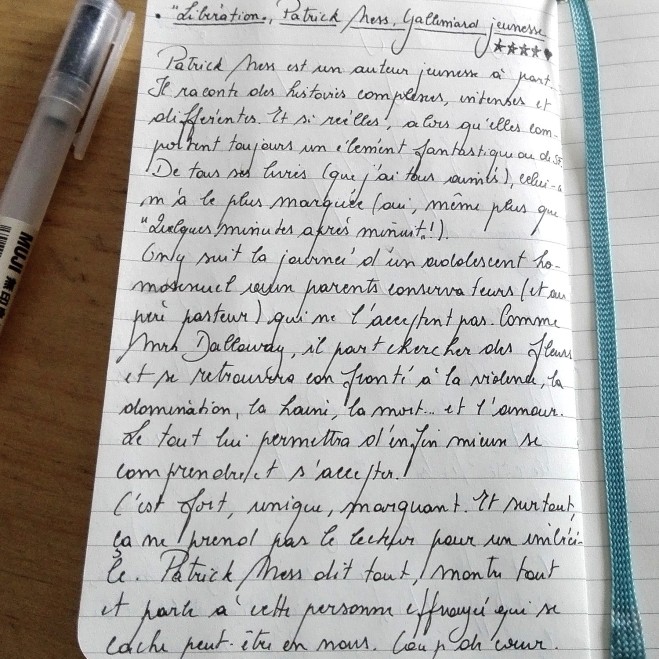
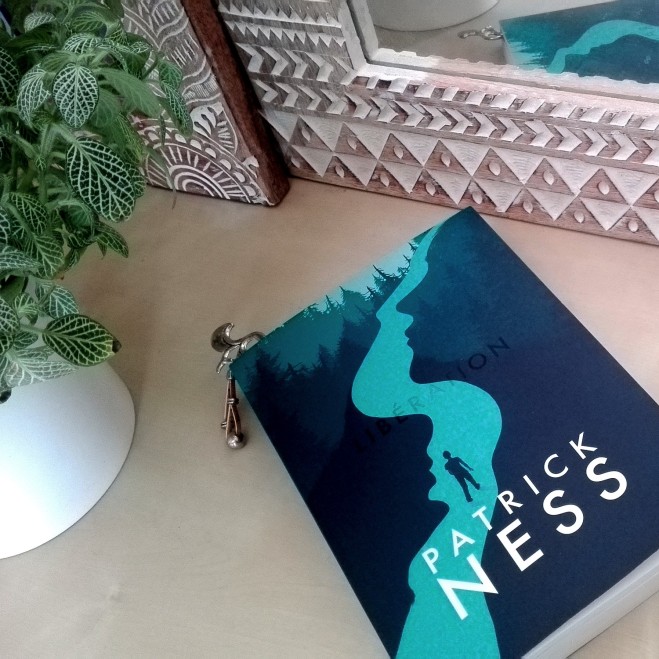
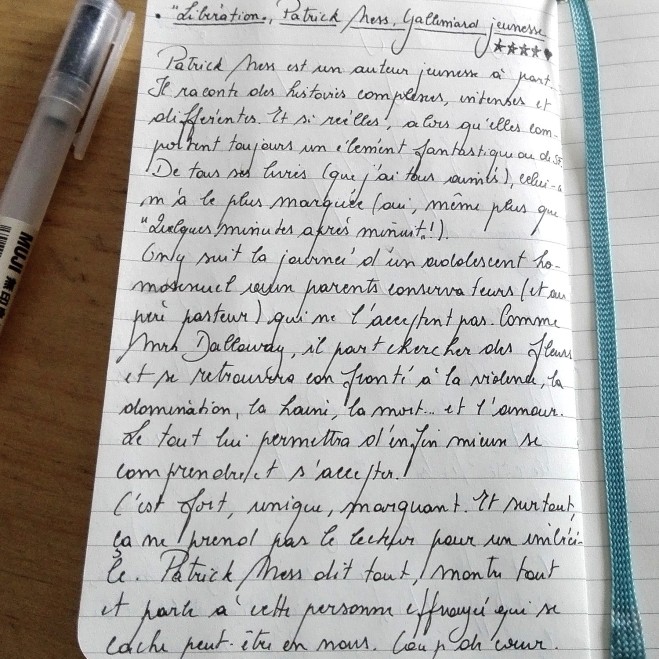

RESUME :
Quelque chose en elle appelait la tyrannie et la terreur, et elle corrompait mes rêves, m’entraînait dans des recoins obscurs que je ne tenais nullement à explorer. Je ne savais plus au juste qui de nous deux était la victime. Peut-être étions-nous la victime l’un de l’autre
Un homme sans nom poursuit obstinément une femme qu’il a aimée jadis – une femme fragile comme le verre, à la chevelure étincelante comme le clair de lune – dans un monde de catastrophe imminente.
Jour après jour, la glace grignotait la courbe du globe, dans une progression que ni les mers ni les montagnes n’entravaient. Elle s’approchait régulièrement, sans hâte ni lenteur, laminant des villes entières, remplissant des cratères d’où avait coulé de la lave en fusion. Il n’y avait aucun moyen d’arrêter les gigantesques bataillons de glace envahissant inexorablement le monde, écrasant, rasant, détruisant tout sur leur passage.
MON AVIS :
Nous sommes tellement habitués à lire des histoires à la narration linéaire et logique que notre première réaction face à quelqu’un qui ne respecte pas ce genre de conventions peut être l’indignation, la frustration, voire le rejet. C’est peut-être pour cela que Neige d’Anna Kavan, ayant pourtant déjà été édité en français avant que Cambourakis ne décide de le publier, n’est pas resté dans nos mémoires (francophones). Et c’est bien dommage…
Le narrateur est un homme ayant un rapport trouble à la réalité, de son propre aveu. Dès lors, difficile de prendre tout ce qu’il dit pour argent comptant. Et pourtant, on se laisse embarquer dans son étrange aventure à la recherche d’une femme qui est unique et fantasme, un être fragile et délicat qui réveille le monstre qui est en lui. Alors que la glace recouvre peu à peu le monde, il fuit en espérant retrouver cette elfe destinée à souffrir encore et toujours. Sera-t-il le prompt chevalier ou le terrible bourreau dans cette histoire ?
Qui eût pu dire qu’une couverture si douce au regard renfermait un récit si cruel ? Et pourtant, sous la plume acide d’Anna Kavan se dessine une histoire qui tient presque du conte. Mais Neige n’est plus à un paradoxe près. C’est que ce livre nous emmène dans un tourbillon. Je n’ai pas de mot plus approprié pour expliquer la chose. Tout démarre simplement. Un homme a été amoureux d’une femme, elle l’a quittée, il la retrouve et elle vit avec un autre. Il veut détester cet autre et considérer sa bien-aimée malheureuse afin de pouvoir fantasmer sur son ravissement, ou plutôt sur son sauvetage. Mais bien vite nous nous demandons à quel point ce narrateur est externe au couple et si ses observations de maltraitance ne sont pas plutôt des souvenirs des sévisses qu’il a lui-même infligés à cette fille si fragile, l’éternelle victime qui accepte son rôle sans rechigner.
Alors que les questions affleurent notre esprit, Anna Kavan, tout en continuant son histoire, se met à répéter ce schéma encore et encore, en l’intensifiant un peu plus à chaque fois, en lui faisant quelque peu quitter le terrain de la réalité également. On pourrait presque croire à une alternance de voix « réalistes » et d’autres « fantasmées » qui nous amènent à revivre les événements selon leur parti-pris. Dans un récit, on chasse le dragon, on se bat pour un roi et on sacrifie les vierges. Dans l’autre, on sauve la pauvre fille d’un tortionnaire pour se battre contre le froid, la glace qui envahit le monde. Mais à partir d’un moment, les deux se confondent pour donner un tout halluciné et hallucinant nous faisant définitivement perdre pied avec la réalité.
Ce tout est quand même perturbant, je dois bien l’avouer. Je suis revenue plusieurs fois sur le paragraphe précédant un changement de ton ou de narration pour voir si je n’avais pas loupé une information avant de réaliser que c’était le parti-pris de l’auteur qui ne souhaitait pas nous ancrer dans la réalité mais qui essayait de nous faire vivre son cauchemar autrement. Et c’est ainsi qu’avec notre consentement, Anna Kavan nous engouffre dans l’horreur d’une relation a proprement parler sado-masochiste (sans que ce ne soit forcément uniquement du point de vue sexuel). La question du monde qui se refroidit dangereusement en devient secondaire, voire anecdotique à certains moments, et semble être surtout là pour fournir un cadre angoissant et une fin mémorable à ce récit qui, sous ses superbes atours, nous offre une descente en enfer purement étouffante à certains moments. Dès lors, pas facile d’arriver à respirer alors qu’on se noie dans les mots de l’auteur…
Pourtant, l’impression finale ne sera pas cruelle mais bien tendre à mes yeux. Je n’arrive pas à comprendre par quelle magie Anna Kavan a réussi à transformer ce récit atroce en une histoire d’amour mémorable. Je pense que je ne le comprendrai d’ailleurs jamais. Mais la dernière image de ce roman me hantera certainement encore longtemps… C’est pourquoi, malgré tout, je conseillerai Neige, tout en insistant bien sur le fait que ce livre est loin d’être agréable à chaque instant et que le lecteur se perdra inévitablement d’une manière ou d’une autre entre ses mots.
Publié pour la première fois le 15 novembre 2013

RESUME:
Un privé à la dérive, Michael McGill, est embauché pour retrouver une version de la Constitution des États-Unis comportant des amendements écrits à l’encre alien invisible. Depuis les années 50, le précieux document est passé de main en main en échange de services louches.
Pour un demi-million de dollars, McGill entre dans ce que l’Amérique a de plus fou, grotesque, déviant et hilarant.
Un livre guidé tambour battant par la logique du pire, l’exploration transgressive d’un pays foutraque et décadent à la recherche de ce qui pourrait modifier le cours de son histoire…
MON AVIS:
Après avoir secoué le monde des comics, Warren Ellis nous offre son premier roman. Est-ce que le scénariste de génie se révèle aussi bon romancier? Oh. Que. Oui.
On retrouve ici tout ce qui fait le « charme » du monsieur: humour trash et déjanté (volontairement à la limite du supportable parfois) qui cache un regard acide mais lucide sur la société. De plus, la liberté qu’offre le roman par rapport au comic permet à Ellis de lâcher sa verve empoisonnée et il nous met dans des situations encore plus tordues… et drôles!
« C’est un document secret rédigé par plusieurs des Pères fondateurs. Il met en lumière leurs véritables intentions pour la société américaine, il contient vingt-trois amendements qui ne peuvent être lus que par le président, le vice-président et le chef de cabinet. C’est un petit volume écrit à la main et soi-disant relié avec la peau d’une entité extra-terrestre qui aurait inspecté le cul de Benjamin Franklin pendant six nuits à Paris, au cours d’un de ses voyages en Europe. Mais Benjamin Franklin n’était pas qu’un auteur nunuche qui se contentait d’écrire des romans sentimentaux sur des aliens lui insérant des objets dans le rectum, tu sais. Le septième soir, il s’est rebellé et il a tué le petit enculé d’un seul coup de poing. » (p. 19) (à noter que si cet extrait vous a rebuté, il vaut mieux éviter de lire le livre, c’est un des plus « légers »…)
Derrière cet humour noir qui flirte allègrement et volontairement avec un mauvais goût très prononcé se retrouvent souvent des réflexions poussées et très justes sur notre société. Ici, Ellis aborde différents sujets tous plus pertinents les uns que les autres. Il parle par exemple de l’évolution qu’a connue ce qui constituait l’univers « underground » (la culture souterraine, cachée, en marge) et celui « mainstream » (la culture reconnue et accessible, celle acceptée et même revendiquée) des dernières décennies.
« Mais réfléchissez: si j’ai pu voir toutes ces choses sur le Net, est-ce qu’elles sont toujours underground?Underground, ça connote quelque chose de caché, de difficile à trouver. Quelque chose qui rampe sous la surface, pas vrai? Mais si on peut les dégoter sur le Net […], on ne peut plus les considérer comme underground. » (p. 176)
Effectivement, ce qu’on considérait il y a encore quelques années comme des attitudes borderlines, à cacher, étranges sont devenues banales et même revendiquées. Comme à son habitude, l’écrivain y va fort pour prouver son propos, mais frappe juste en même temps:
« Ça a fait un choc, la première fois qu’on en a montré, et maintenant, on voit des sodomies dans tous les films[porno]. Le public gobe tout ça et dit, Qu’est-ce qu’on va avoir ensuite? Qu’est-ce qu’on a de nouveau? Toutes ces pratiques qu’on a cachées pendant des années, elles sont devenues mainstream, aujourd’hui. […] Si les gens veulent vraiment s’inquiéter, dites-leur de s’inquiéter de ce qui va suivre. De ce qui vient après nous. » (p. 36)
Ellis aborde aussi la problématique de l’information. En nous parlant d’un système de diffusion de celle-ci aussi ingénieux que logique, il nous donne l’idée d’une arme médiatique des plus puissantes. Je me demande combien de temps il faudra pour réellement la voir naître, et je dois dire que j’ai hâte de voir la chose, car c’est une sacrément bonne idée qu’il nous offre (je ne la développerai pas ici pour vous en laisser la surprise).
Le hasard a aussi voulu que je lise ce roman trash tout juste après l’essai très conventionnel de Bruckner, L’Euphorie perpétuelle. Or, les deux livres abordent certains sujets qui se recoupent. En effet, Bruckner parle dans son essai de la manière dont les relations amoureuses ont évolué grâce à/à cause de la permissivité des dernières décennies et finissent par prôner une solution très conservatrice dans ses termes, même si présentée sous les allures d’une évolution. Ellis aborde la même problématique dans son roman. Il oppose la volonté de retourner à une sexualité « sage » avec tout ce que ça implique (homosexualité réprimée et femme bien docile) et les excès de plus en plus écœurants que cette nouvelle permissivité entraîne (comme la revendication de certaines perversions sexuelles qui devraient plutôt choquer car impliquant des relations avec des êtres – humains ou pas – non consentants). Là où l’un propose une solution un peu extrême à un problème qui se situe à l’autre extrême, l’autre apporte un regard réfléchi et dénué de manichéisme sur ledit problème. En effet, étonnamment, Ellis réussit dans ce roman là où Bruckner a échoué dans son essai: il nous offre une réflexion nuancée sur les relations amoureuses et sexuelles à notre époque.
Mais avant tout, ce que nous apprend Ellis ici, c’est à nous méfier des apparences. Il nous présente souvent des personnages qui, sous des allures de perversions et autres, se révèlent en fait ingénieux, humains, attachants ou intelligents. Qui nous apprennent surtout à voir plus loin que le bout de notre nez et de nos préjugés. On ne se met pas forcément à les aimer pour autant, rassurez-vous, mais on apprend à les comprendre, un peu comme dans les chroniques de Palahniuk dans Le Festival de la Couille.
Voilà qui caractérise en fait l’écriture de l’auteur et qui en constitue sa force: il n’a pas froid aux yeux et mêle habilement humour et conscientisation. Il n’offre pas une dénonciation facile mais creuse son sujet et nous choque pour nous pousser dans les retranchements de notre réflexion. Il nous provoque pour nous faire réaliser que notre mode de penser est peut-être un peu trop cadré par ce qu’on nous a appris à croire. Il réveille les consciences, et ça fait un bien fou. C’est pour ça qu’il serait dommage de s’arrêter à l’aspect trash de l’écriture d’Ellis. Car derrière celui-ci se cache une réflexion bien plus riche et recherchée que dans la plupart des romans – et essais – plus sages et « bien-pensants »…
Un mot aussi sur la forme avant de conclure. Artères souterraines est un premier roman et comporte de ce fait quelques défauts auxquels on pouvait s’attendre, facilement pardonnables cependant. Le plus « visible » étant la structure adoptée par l’auteur: on sent clairement le format « comic » derrière chaque page. Les blagues et les chutes sont très « formatées », faites pour rentrer dans des bulles et des cases. La succession des situations est découpée en « épisodes », à la manière des comics. Cependant, même si ce défaut est très présent, il ne m’a pas du tout gênée, me donnant même d’une certaine manière l’impression de me retrouver à nouveau dans le monde de Transmetropolitan, d’autant plus que les diverses scénettes présentées ici le sont dans le même ton que celui de la série et que le personnage principal semble être une sorte d’ersatz plus jeune de Spider Jerusalem, avec un cynisme un peu moins marqué mais une conscience et un sens de la morale toujours aussi forts et présents.
Au final, la première incursion d’Ellis dans le monde des romans est une véritable réussite et ne peut que nous amener à en souhaiter d’autres. Mais je dois quand même préciser que c’est un bouquin très provocateur qui risque (vraiment) de choquer certaines personnes. Alors autant l’aborder en sachant à quoi s’attendre. En tout cas, je n’avais plus pris autant de plaisir à lire un livre de la première à la dernière page depuis longtemps.
Publié pour la première fois le 17 novembre 2010

RESUME:
Immeubles de Grande Hauteur… c’est le nom que les architectes et les urbanistes ont donné à leurs constructions les plus ambitieuses et les plus inquiétantes. Plus que des résidences, les tours sont des mondes verticaux encastrés entre terre et ciel — autant dire nulle part. C’est là que s’élabore l’homme de demain. I.G.H. raconte la rapide dégradation de la qualité de la vie dans un immeuble de mille appartements répartis sur quarante étages. La population initialement homogène de ces logements coûteux ne tarde pas à se scinder en clans. Les querelles entre voisins dégénèrent en guerres tribales. Les aliénés installés là explorent peu à peu tout l’éventail de possibilités inédites que leur offre l’existence dans ces cellules capitonnées d’un nouveau genre, les civilisés retournent à la préhistoire et le récit, commencé dans le pétillement du champagne, s’achèvera dans le sang.
MON AVIS:
J’ai rencontré J. G. Ballard avec un court roman qui nous livrait une vision troublante de notre société et qui avait pourtant été écrit il y a plus d’un quart de siècle (Sauvagerie, paru précédemment sous le titre de Le massacre de Pangbourne). Il m’aura fallu attendre deux autres livres de l’auteur pour me retrouver de nouveau confrontée à cette lucidité perturbante qui m’avait tellement marquée dans Sauvagerie. Mais je vous laisse plutôt juger par vous-même (je sens que je vais beaucoup citer le livre dans ce billet)(j’ai noté plein de passages, le tout sera de ne pas tous les mettre!):
« Un nouveau type social allait naître dans la tour, une personnalité nouvelle, plus détachée, peu accessible à l’émotion, imperméable aux pressions psychologiques de la vie parcellaire, n’éprouvant pas un grand besoin d’intimité: une machine d’une espèce perfectionnée qui tournerait fort bien dans cette atmosphère neutre. L’habitant satisfait de ne rien faire sinon de rester assis dans son appartement trop coûteux, regarder la télévision avec le son baissé et attendre que le voisin fasse un faux pas. […] Leurs adversaires étaient des gens satisfaits de leur vie dans la tour, des représentants d’une nouvelle race qui ne voyait aucun inconvénient à vivre dans un paysage anonyme de béton et d’acier, qui ne cillaient pas devant l’invasion de leur vie privée par des officines gouvernementales et des organismes de classement de fiches et d’analyse de données – mieux: qui accueillaient peut-être favorablement ces manipulations invisibles, certains de pouvoir les utiliser à leurs propres fins. Ils étaient les premiers à maîtriser un nouveau mode d’existence du XXesiècle finissant. […] De bien des manières, la tour représentait l’achèvement de tous les efforts de la civilisation technologique pour rendre possible l’expression d’une psychopathologie vraiment « libérée ». » (pp. 43-44) (N.B.: c’est moi qui souligne)
Juste pour rappel, ce livre a été écrit en 1975. Ça laisse songeur, hein…
Ballard nous livre ici un véritable cauchemar urbain dont le personnage principal est un amas de béton, de verre et d’acier, un immeuble de 40 étages qui abrite 2000 appartements et qui permet à ses habitants de vivre en quasi autarcie (dans les limites du possibles s’entend). Cette véritable personnification de la tour fait de celle-ci une entité qui dévore les hommes en les isolant du vrai monde. Mais cette isolation, ils la recherchent. Car, après tout, ce « vrai monde » est là, dehors, à portée de main, personne ne les empêche de sortir et de s’échapper de la tour, juste eux-mêmes.
Mais que se passe-t-il exactement? Dans cet immeuble déjà hiérarchisé selon l’étage auquel on vit (les plus riches en haut, les moins bien lotis en bas… ça vous rappelle quelque chose?), un petit incident va faire déraper les choses, au point d’amener dans un univers que l’on pourrait presque qualifier de « surcivilisé » un nouvel état sauvage. Les éléments déclencheurs, somme toute « anodins », ne sont là que pour faire resurgir chez les habitants leurs instincts les plus primitifs et bas, aussi. Pour ce faire, Ballard utilise quelques notions sociologiques qui ont commencé à émerger dans la décennie précédente (Milgram mais pas que)(ça me rappelle mes études tout ça!):
« Wilder se rappelait le saisissement éprouvé, lorsqu’il avait passé sur son balcon, non à la vue du cadavre, mais à celle du public considérable qui s’étageait jusqu’au ciel. Quelqu’un s’était-il chargé d’appeler la police? Pour Wilder la chose était allée de soi, mais à présent il avait des doutes. Il lui semblait difficile d’admettre que cet homme maniéré et imbu de lui-même eût songé à se suicider. Or, personne ne se posait la moindre question; les gens acceptaient l’éventualité du meurtre de la même manière que les nageurs de la piscine acceptaient la présence des bouteilles de vin et des boîtes de bière qui roulaient sous leurs pieds lorsqu’ils arpentaient le sol carrelé. » (p. 68)
Ce n’est pas le seul exemple du genre. Ballard parsème son livre de réflexions sociologico-pessimistes malheureusement d’une actualité (et d’une réalité) effrayante. On se retrouve ainsi embarqués à la découverte d’une micro-société qui se désagrège à la vitesse grand V pour revenir vers un état bestial, d’une simplicité qui semble rassurante pour ces personnes qui vivaient sous le joug de la modernité…
« Ce qui intéressait surtout Royal était la manière exagérément brutale dont les habitants, de plus en plus, réagissaient au climat de la tour. Ils endommageaient délibérément les ascenseurs et les appareils de climatisation, créaient un appel de puissance excessif avec leur équipement électrique. Cette négligence à l’endroit de leur propre confort dénotait un phénomène de redistribution des priorités dans leur esprit – peut-être, aussi, l’apparition de ce nouvel ordre social et psychologique que guettait Royal. » (p. 94)
Le tout avec un humour corrosif, parfois même écœurant, qui fait souvent mouche sans pour autant faire rire (ou jaune alors):
« En dépit du lien de fidélité qui les unissait, et de l’affection que Wilder portait à l’animal, celui-ci ne tarderait pas à le quitter. Lorsqu’ils auraient atteint la terrasse, ils participeraient tous deux à un dîner pour fêter leur victoire; mais, songea Wilder avec une pointe d’humour noir, le caniche serait dans la marmite. » (p.194)
Et l’histoire d’avancer vers l’absurde presque et, en même temps, de nous faire craindre une résolution hâtive et décevante. Jusqu’à ce qu’on découvre le dernier paragraphe, magistral, qui colore tout le récit…
L’histoire reste après la lecture et elle nous travaille. En fait, je dirais même que son impact ne se fait réellement sentir qu’une fois le livre abandonné dans un coin, quand tout ce qu’on vient de lire tourne et retourne tout doucement dans notre tête.
Avant de finir, une petite note négative quand même. Bon, vous allez trouver que je suis embêtante à toujours revenir sur ce type de détails mais j’y tiens, parce que c’est symptomatique du genre à cette époque après tout… Encore une fois, et comme je le dis souvent pour Philip K. Dick, je n’aimerais pas être un personnage féminin chez Ballard. Entre les mères de familles imbéciles qui se dévoueront à leur progéniture et les femmes qui finissent toujours par être plus ou moins soumises, il y a peu de place pour un personnage féminin réellement intéressant et un tant soit peu élaboré. C’est quand même frustrant de sortir d’un livre qu’on a aimé en se disant : « Purée (mis pour un autre mot)(oui, je reste polie ici), on dirait qu’il se fout de ma gueule (ah, pardon, ça m’a échappé), les femmes n’ont pas le droit d’avoir un minimum d’intelligence et de jugeote ou quoi??? ». Zut, quoi, aussi, ras-le-bol à la fin!
Au final, I.G.H. est un livre « trash » mais d’une actualité incroyable, même si, encore une fois, il est un peu froid dans son traitement (en même temps, c’est aussi le sujet qui le demande)… Un classique parfois un peu dur à avaler mais d’une lucidité effroyable.
Publié pour la première fois le 21 mai 2010